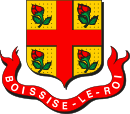Selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le Rapport Brundtland1, le développement durable est :
« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »
Face à l’urgence de la crise écologique et sociale qui se manifeste désormais de manière mondialisée (changement climatique, raréfaction des ressources naturelles, écarts entre pays développés et sous-développés, perte drastique de biodiversité, catastrophes naturelles et industrielles), le développement durable (ou développement soutenable, anglicisme tiré de Sustainable development) est une réponse de tous les acteurs (États, marché, société civile) pour reconsidérer la croissance économique à l’échelle mondiale afin de prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux du développement.
Il s’agit aussi, en s’appuyant sur de nouvelles valeurs universelles (responsabilité, participation et partage, principe de précaution, débat, innovation, …) d’affirmer une approche double :
- Dans le temps : nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre mais le devoir d’en assurer la pérennité pour les générations futures ;
- Dans l’espace : chaque humain a le même droit aux ressources de la Terre (principe de destination universelle des biens).
Le développement durable est un élargissement de la notion d’intérêt public, qui caractérise les États dans la mise en œuvre d’office de leur ministère public. C’est un mode de gouvernance proposé par les États, les organisations non gouvernementales et les entreprises transnationales, pour répondre aux préoccupations de la société civile en ce qui concerne les impacts environnementaux et sociaux de l’activité des agents économiques sur leurs parties prenantes.
Tous les secteurs d’activité sont concernés par le développement durable : l’agriculture, l’industrie, l’habitation, l’organisation familiale, mais aussi les services (finance, tourisme,…) qui, contrairement à une opinion quelquefois répandue, ne sont pas immatériels.
1. Du nom de Gro Harlem Brundtland, ministre norvégienne de l’environnement présidant la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, ce rapport intitulé Notre avenir à tous est soumis à l’Assemblée nationale des Nations unies en 1986
Quelques conseils
Contrôler le débit des robinets
Réduction du débit d’eau par équipement :
- robinet mitigeur : 10%
- aérateur (ou mousseur) : 30 à 40%
- pomme de douche « éco » : 50%.
Je contrôle le débit des robinets. Je ne jette rien dans les toilettes.
Une double action
Économiser l’eau chaude, c’est économiser à la fois l’eau et l’énergie nécessaire à son chauffage. Il existe aujourd’hui des dispositifs simples, à poser sur les robinets ou les flexibles de douche, qui limitent sensiblement la consommation, tout en conservant la même efficacité d’utilisation.
La bonne position
Laisser de préférence les robinets mitigeurs en position « froid » pour éviter de demander de l’eau chaude ou tiède alors qu’on a besoin, la plupart du temps, d’eau froide.
Je préserve l’eau
Profiter du soir pour arroser un jardin en été, la tombée du jour est le moment idéal, car plates-bandes et potagers auront toute la nuit pour se désaltérer. En binant la terre avant, l’arrosage sera encore plus efficace. De même, le pied des plants peut être paillé pour limiter l’évaporation.
Remercier la pluie
L’eau de pluie est un bienfait que l’on peut récupérer à partir des gouttières dans des bacs, ou mieux, des citernes (il en existe de toutes tailles). Cette eau servira à l’arrosage des plantes, du jardin, ou aux lavages divers. Par ailleurs, un gazon que l’on laisse pousser un peu plus haut devient plus résistant à la sécheresse et économise l’eau d’arrosage.
Sous la chaleur du soleil, 60% de l’eau s’évapore avant même d’avoir été absorbée par les plantes.
Moins d’eau
Les appareils économes divisent la consommation d’eau par 2 voire 3 selon les modèles. Il existe aujourd’hui des lave-linge utilisant seulement 40 litres d’eau par cycle (sans prélavage) et des lave-vaisselle consommant moins de 15 litres (plus économes en eau qu’une vaisselle faite à la main).
Lutte contre les fuites
Vérifier le débit
Un bon moyen pour traquer les fuites d’eau, c’est de relever le compteur le soir avant de se coucher et de faire la même chose le matin, sans avoir ouvert ni robinet ni appareil ménager : si les chiffres sont identiques, tout va bien. Sinon, il y a une fuite. Au total, les fuites sont à l’origine d’un gaspillage qui représente 20% de notre consommation.
Retrousser ses manches
La plupart du temps, il s’agit d’un simple joint défectueux : cela vaut la peine d’apprendre à le changer.
Les fuites (en eau potable gaspillée par jour) :
- Un robinet = jusqu’à 120 litres
- Une chasse d’eau = 600 litres soit la consommation/jour d’une famille de 4 personnes.
L’éco-prêt à taux zéro
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements.
Ce prêt peut être accordé au propriétaire bailleur ou occupant d’un logement ancien, et au syndicat de copropriétaires jusqu’au 31 décembre 2021.